
PHYTO-ACTUALITES - 2
L'Interview, par Pierre MORIN
PHYTO-THERAPIE
PHYTO-COURRIER
PHYTO 2000
 |
PHYTO-ACTUALITES -1 PHYTO-ACTUALITES - 2 L'Interview, par Pierre MORIN PHYTO-THERAPIE PHYTO-COURRIER PHYTO 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monsieur Bernard B., âgé de 40 ans, est en pleine santé apparente lorsqu'au début du mois d'octobre 1984 il commence à ressentir une envie pressante d'uriner, accompagnée de discrètes brûlures à la miction. Ce signe, inhabituel chez lui, ne l'inquiète tout d'abord pas. Il le met sur le compte d'un voyage qu'il vient de faire, et pense qu'il s'agit d'un "échauffement". En quelques jours celui-ci s'accentue et commence à l'handicaper tellement qu'il décide de consulter son médecin. Ce dernier lui prescrit un petit désinfectant urinaire, en l'assurant qu'il s'agit d'un trouble banal et que tout cela va rentrer dans l'ordre rapidement. Loin de s'amender, les symptômes s'accentuent. Les brûlures à la miction se font de plus en plus vives, et les envies d'uriner de plus en plus fréquentes.
Une dysurie intense s'installe, accompagnée d'un état fébrile et d'un sentiment de malaise général. Les résultats du prélèvement d'urines, que le généraliste a demandé quarante huit heures auparavant, reviennent le 25 octobre 1984. Ils montrent que l'infection est franche. Les urines contiennent beaucoup de pus. On y trouve de très nombreux globules blancs altérés en amas, quelques cellules de la vessie et de nombreux cristaux d'oxalate. La présence de sang est aussi mise en évidence avec vingt mille hématies par millilitre. L'examen direct montre de très nombreux bacilles Gram négatif. Leur mise en culture révèle des colonies d'Escherichia Coli., dont le nombre s'élève à dix millions par millilitre. Leur sensibilité est testée au laboratoire, et les données de l'antibiogramme montrent que plusieurs antibiotiques sont capables de les détruire.
Le problème à résoudre est donc simple. Un germe a été identifié dans les urines de cet homme jeune. Sa prostate est très douloureuse au toucher rectal. Nul doute qu'il ne s'agisse là d'une première poussée de prostatite. Il est donc impératif de mettre en place un traitement énergique. En effet, les risques sont bien trop grands que l'infection ne se développe, et que les germes ne s'installent pour une longue durée dans la glande. Avec toutes les conséquences que cela implique. Le risque d'installation chronique des troubles, et secondairement d'une stérilité qui est l'un des dangers les plus redoutables de ce type d'affection chez l'homme. Or, nous tenons le responsable : le colibacille. L'organe dans lequel il est implanté a été identifié : la prostate. L'arme qui peut le détruire a été découverte par le laboratoire : l'antibiotique. Tout est donc évident. Le malade doit guérir très vite puisqu'on a le coupable, et que la sanction thérapeutique va être appliquée de façon stricte.
Le médecin modifie alors la prescription et l'adapte de manière très précise, en prescrivant, comme l'indique l'antibiogramme, le Bactrim puis l'Apurone pour une durée de trois semaines. Très classique, puissant et habituellement efficace, ce traitement est donc établi selon les critères les plus scientifiques et les plus rigoureux de la médecine moderne. Au terme de ce laps de temps, la guérison doit être obtenue puisqu'on tape fort et longtemps. Mais le microbe ne l'entend pas de cette oreille. Sans doute aguerri par d'autres combats, il résiste à l'attaque qui lui est portée. Et continue son agression. Les jours passent, mais le malade pisse de plus en plus difficilement. Comme si le germe trouvait dans son adversaire les moyens d'une force nouvelle lui permettant d'occuper et de détruire encore plus le territoire qu'il occupe et qu'il n'entend pas quitter. Plus la fourniture d'armes pour le pulvériser se fait insistante, moins les munitions fournies à la prostate semblent efficaces contre lui. Le territoire prostatique envahi est-il en passe d'être perdu par l'organisme ? L'agresseur possède-t-il une telle virulence qu'il réussit non seulement à déjouer les attaques violentes qui lui sont portées par l'antibiotique, mais qu'il établit un rempart contre lui en se cloisonnant dans un territoire où il se terre ? La lutte de l'organisme livré à ses seules ressources, mais appuyé par l'aide de son allié antibiotique qu'il a de plus en plus de mal à supporter, est acharnée car les troubles s'aggravent. Ils ne sont plus seulement urinaires maintenant, mais ils se complètent de nausées et de dégoût pour la nourriture. Trois semaines se sont écoulées. L'échec du traitement chimique moderne est évident. Malgré la puissance de feu des armes utilisées, un statu quo n'a même pas pu être obtenu. L'état général du patient est de plus en plus altéré.
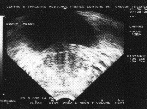
Devant l'aggravation de ses troubles, cet homme, qui dirige une équipe de chercheurs poursuivant des expériences de physique fondamentale dans un grand centre de recherches français, est complètement dérouté et ne comprend pas ce qui lui arrive. Physicien nucléaire de haut niveau, il a une idée très précise de la science. Pour lui, lorsqu'un problème est bien posé, une méthodologie scientifique rigoureuse ne peut qu'aboutir à une solution juste, et les fausses solutions ne sont que le fruit d'une erreur dans le raisonnement. L'idée qu'il se fait de la médecine l'amène à croire qu'elle a bien posé les données initiales de sa prostatite, et que sa démarche est juste. Mais alors, pourquoi souffre-t-il de plus en plus ? Pourtant, il ne lui semble pas qu'une erreur ait été commise dans la façon dont il a été soigné depuis maintenant plus d'un mois. La science médicale moderne a bien décrypté la cause des maladies infectieuses, depuis que Pasteur a révolutionné la médecine en apportant la preuve que les microbes étaient les seuls responsables !! Et les progrès ont apporté des armes tellement efficaces contre eux !!
C'est alors que sa femme, inquiète de voir son mari dans un état qui se dégrade de plus en plus, décide de nous l'envoyer en consultation. Depuis plusieurs années, elle a recours à la PHYTOTHERAPIE pour elle et pour leurs filles, mais jusqu'à présent n'a pas réussi à le convaincre de l'efficacité des plantes médicinales. Pensez donc ! Une médecine de "bonne femme". Pour un chercheur d'un tel niveau ! Comment sa formation scientifique pourrait-elle lui faire croire au sérieux de ces traitements dont la médecine ne veut même pas entendre parler et qu'elle rejette en prétextant qu'ils sont "hors la science" ?
Mais la douleur est devenue si permanente, que le patient est prêt à tout essayer pour tenter de trouver un soulagement à ses troubles. C'est un homme très éprouvé qui se présente alors à nous. Les signes qu'il affiche sont très marqués, et l'apparition d'une incontinence nécessite un arrêt de travail, car il ne peut plus retenir ses urines. L'examen clinique attentif ne se limite pas à scruter les seules voies urinaires, mais s'efforce de chercher les raisons qui expliquent que cet homme jeune ait pu présenter un lâchage si brutal de ses défenses anti-infectieuses au niveau de la sphère génito-urinaire.
Comme on pouvait s'y attendre, il existe une congestion pelvienne importante. Celle-ci n'est jamais prise en compte dans les traitements officiels tels que les promeut la médecine. Et pourtant, elle joue un rôle important dans le déclenchement et l'installation des infections urinaires, celles de l'homme comme de la femme. Isolant en quelque sorte la prostate du reste de l'organisme, elle la livre au germe, gênant ainsi l'apport des moyens de la défense plus générale que le corps pourrait lui donner. Mais il faut aller plus loin, et tenter de comprendre quels éléments de la régulation de la circulation pelvienne sont impliqués, et les raisons pour lesquelles ils se sont ainsi constitués.
De proche en proche, la réflexion est amenée à progresser. Partant de l'analyse de l'état neurovégétatif local et locorégional, elle étudie son intrication avec les mécanismes métaboliques plus généraux qui ont pu participer à cette fragilisation de la prostate. Elle replace ainsi le rôle du système immunitaire général dans ses relations avec le pancréas, dans ses deux fonctions, exocrine et endocrine, et le foie, organes impliqués dans la gestion de son équilibre. Ceux-ci, bien entendu, doivent être eux situés dans l'exacte relation qu'ils établissent avec les autres organes et avec l'ensemble de l'organisme.
Nous sommes ainsi apparemment bien loin du germe. Et pourtant ce sont tous ces facteurs intriqués qui expliquent en réalité la maladie. Il est bien connu qu'un microbe ne peut se développer que s'il trouve dans le milieu où il prend racine les éléments qui vont lui permettre de se nourrir et de subsister. Modifiez le sol d'un champ, et le chiendent disparaît comme par enchantement. Or, le germe est bien dans la prostate de Monsieur Bernard B. Et la prostate fait évidemment totalement partie de l'ensemble de son corps. On peut donc aisément comprendre que, si nous avons la connaissance la plus exacte possible de tous les facteurs du "sol" qui assurent l'équilibre du "champ prostate", ou qui ont provoqué son déséquilibre, nous ayions toutes les chances que le colibacille qui s'est installé sur ce "champ prostate" disparaisse comme le chiendent, si nous corrigeons le sol. C'est là un des buts des traitements de terrain.
Au terme d'une réflexion qui va tenir compte de toutes les données, même anodines, que le patient peut nous fournir sur l'ensemble de sa vie, et qui sont confrontées aux renseignements apportés à la fois par l'examen clinique et les bilans déjà effectués, il est décidé de mettre en place un premier traitement de terrain le 15 novembre 1984. Il sera éventuellement complété lorsque nous recevrons les résultats d'autres examens complémentaires qui ont été demandés, et parmi lesquels une échographie de la prostate malade, car nous souhaitons avoir des références objectives qui permettront de suivre de façon mesurable l'efficacité ou non du traitement. Son but initial est d'assurer une décongestion de toute la région prostatique, et d'apporter bien sûr des éléments à même de favoriser la lutte anti-infectieuse au niveau de l'appareil génito-urinaire du patient, tout en tentant de corriger les distorsions générales que nous avons pu identifier.
Si nous avons été amenés à retenir la bruyère, la busserole, le cajeput, le chêne pédonculé, le chèvrefeuille, l'hamamélis, la lavande, la myrtille et la verge d'or, c'est parce que ces plantes étaient le mieux à même de répondre aux anomalies que l'examen clinique avait pu mettre en évidence, et parce qu'elles présentent une action antimicrobienne très large, et qui a été prouvée en laboratoire, sur le colibacille, le bacille d'EBERTH, l'entérocoque, le proteus, le staphylocoque et le streptocoque.
Leurs effets conjugués dans des préparations magistrales, permettent d'obtenir un plein exercice de leurs propriétés anti-infectieuses génito-urinaires et intestinales, anti-inflammatoires, antispasmodiques musculotropes et neurotropes, analgésiques, sympatholytiques, sédatives du système neuro végétatif, cholérétiques, diurétiques, de décongestion splanchnique et pelvienne, vasoconstrictrices veineuses, protectrices de la circulation capillaire, hypoglycémiantes indirectes, antihémorragiques, antigonadotropes et stimulantes des glycocorticoïdes.
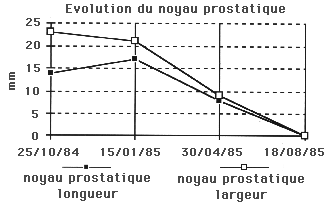
L'échographie de la prostate est pratiquée le 30 novembre 1984 et confirme le diagnostic clinique de prostatite. Cet examen, facile à réaliser, n'est pas du tout douloureux et représente un progrès technique intéressant pour le suivi d'une affection comme celle que présente Bernard B. En visualisant les organes, il permet en effet de "voir" leur aspect, de les mesurer et de repérer éventuellement certaines de leurs anomalies. Ici, il va montrer que la vessie ne présente pas de défaut particulier, et que la taille de la prostate est tout à fait normale (30 mm d'épaisseur, 35 mm de largeur). Par contre, il met en évidence, en regard du prolongement prostatique postérieur du lobe latéral droit, un noyau de prostatite hypoéchogène, de 14 mm de long sur 23 mm de large. Il révèle aussi une cavité un peu hypotonique au niveau du pôle moyen du rein gauche, mais pas de stase franche, et le reste de l'examen abdomino-pelvien est sans particularité.
Lorsque le 3 décembre 84 nous revoyons le malade pour prendre connaissance de ce résultat, quinze jours se sont écoulés depuis qu'il a commencé son traitement de terrain. Et malgré l'arrêt des antibiotiques, qui avait alors été décidé en raison de leur inefficacité, nous n'assistons pas à une exacerbation des troubles. Nous n'assistons pas non plus à une guérison miracle en un temps aussi court. Mais de petits indices d'une amélioration apparaissent : moins de pertes d'urines, brûlures moins violentes en urinant. Tel un cheval lancé au galop, la prostatite en pleine poussée infectieuse doit être d'abord stoppée dans son élan. Nous décidons alors de compléter le traitement en cours par l'adjonction d'autres plantes décongestionnantes (achillée millefeuille, kawa-kawa). Nous intensifions aussi l'apport des éléments anti-infectieux en prescrivant une préparation à base d'huiles essentielles à introduire en lavement rectal.
L'avantage de cette voie d'administration de certains principes phytothérapiques est qu'elle permet de les apporter directement au voisinage de la prostate. Grâce à leur extrême pouvoir de diffusion, ils peuvent en se dispersant dans le petit bassin venir directement en contact avec les germes cachés dans le noyau infecté de la prostate. N'oublions pas que ces substances naturelles figurent au nombre des produits les plus antiseptiques que l'homme connaisse. Si nous pouvons observer au microscope des fragments d'intestins intacts de momies vieilles de quatre mille ans, c'est parce qu'elles ont été embaumées dans des onguents à base justement de tels produits, et qu'ils ont empêché toute putréfaction par les microbes !
| 25/10/84 | 15/01/85 | 30/04/85 | 18/08/85 | |
|---|---|---|---|---|
| hématies | 2000 | 2000 | ||
| germes | 10.000.000 | <1000/ml | stérile | stérile |
| leucocytes | plus +++ | 1.000 | ||
| noyau prostatique longueur | 14 mm | 17 mm | 8 mm | 0 mm |
| noyau prostatique largeur | 23 mm | 21 mm | 9 mm | 0 mm |
| noyau prostatique épaisseur | 3 mm |
Six semaines plus tard, le 15 Janvier 1985, nous revoyons le malade muni des résultats de son bilan de contrôle. Son état urinaire s'est complètement corrigé, il ne se lève plus la nuit pour uriner, et la fréquence de ses mictions est redevenue normale. Les douleurs ont disparu en une semaine. Il persiste seulement une sensibilité toute particulière au froid qui déclenche des envies impérieuses d'uriner, indiquant là que, malgré l'importante amélioration des troubles que le malade éprouve, tout n'est pas encore rentré dans l'ordre.
Ce que va confirmer l'échographie en montrant l'image hypoéchogène du prolongement caudal prostatique droit : la zone pathologique mesure encore 21 mm de large, 17 mm en hauteur, et 3 mm d'épaisseur. L'examen cytobactériologique des urines est par contre lui normal, et la stérilisation acquise. Le nombre de leucocytes a chuté à mille par millilitre, celui des hématies à deux mille par millilitre, chiffres tout à fait normaux. Il persiste de rares cocci gram positif, à moins de mille par millilitre, identifiés comme un banal staphylococcus epidermidis de contamination, sans signification.
Devant son efficacité et la nécessité de continuer à agir en profondeur et de façon durable sur les éléments perturbés, nous reconduisons le même traitement pour une durée de trois mois. Afin de soutenir l'organisme dans sa lutte, nous décidons d'ajouter des extraits de bourgeons de cassis, aux effets anti-inflammatoires, stimulants de la fonction glycosurrénalienne et réducteurs de la stimulation réactionnelle des androgènes surrénaliens dont il apparaît clairement que la freination s'impose.
Le contrôle des urines du 30 Avril 1985 confirme qu'elles restent stériles. A l'échographie il persiste une petite zone échogène de neuf millimètres de grand axe. Et le radiologue conclut : "nette régression des images pathologiques sous traitement". Monsieur Bernard B. est en parfaite santé depuis de nombreux mois et n'accuse plus aucun trouble d'aucune sorte. Mais la prudence est de règle face à ce genre d'affections qui ont une très forte tendance à récidiver ou à se chroniciser. Certes le germe semble avoir disparu, mais les urologues savent qu'il peut rester quiescent dans les noyaux prostatiques résiduels et se réveiller brutalement à l'occasion d'un surmenage, d'une fatigue ou d'un choc émotionnel. Il nous faut donc expliquer au patient qu'il ne présente certes plus aucun signe de sa prostatite, mais qu'un traitement poursuivi s'impose.
Il nous faut récupérer complètement le territoire perdu, et reconquérir ce petit noyau de neuf millimètres qui persiste dans sa prostate, comme un pied de nez que nous ferait le germe. Nous n'indiquerons pas les éléments qui ont été prescrits dans le traitement du 8 Mai 85, sinon pour signaler qu'il fut très allégé, et toujours adapté au niveau évolutif spécifique du patient, qui est à chaque fois évalué de façon très précise. C'est la condition indispensable à l'établissement d'un traitement qui soit véritablement de terrain.
Le 18 Août 85, la guérison totale, avec restitution de la prostate à l'état antérieur à la maladie, était confirmée par la dernière échographie pratiquée. Douze années se sont écoulées depuis. A deux reprises, à l'occasion d'un surmenage professionnel intense, Bernard B. a ressenti les premiers signes d'une nouvelle attaque de sa prostate, traduisant une baisse de son potentiel de défense qui cédait du terrain face à un germe, colibacille ou autre, à l'affût d'une terre à reprendre. A chaque fois, en quelques jours du traitement à base d'huiles essentielles qu'il s'administre en lavement, tous les signes disparaissent, comme si le microbe reconnaissait immédiatement les agents responsables de sa défaite passée. Il n'existe probablement pas actuellement de physicien français aussi farouchement convaincu de l'efficacité des plantes médicinales. Il n'est pas pour autant tombé dans un prosélytisme forcené, mais il acquiesce totalement quand l'une de ses filles, maintenant âgée de 20 ans, vient consulter pour la sévère spasmophilie dont elle est atteinte.
- Effet thérapeutique positif là où un traitement antibiothérapique bien conduit n'obtenait pas l'effet escompté.
- Amélioration des signes cliniques (dysurie, pollakiurie nocturne) très rapidement obtenue dès l'institution du traitement phytothérapique.
- Réalité de l'activité du traitement objectivée par :
Il s'agit donc d'un homme jeune, sans antécédents urinaires, ayant présenté vers la quarantaine une infection génitale (prostatite) avec un foyer visualisé en échographie.
Sous l'effet d'un traitement associant des éléments phytothérapiques par voie loco-régionale et générale, on a assisté à une disparition complète de l'infection urinaire au bout de trois semaines, avec une diminution importante des images perturbées au niveau de la prostate. La guérison définitive, avec disparition totale des signes échographiques a été obtenue en cinq mois. Elle s'est maintenue jusqu'à ce jour.